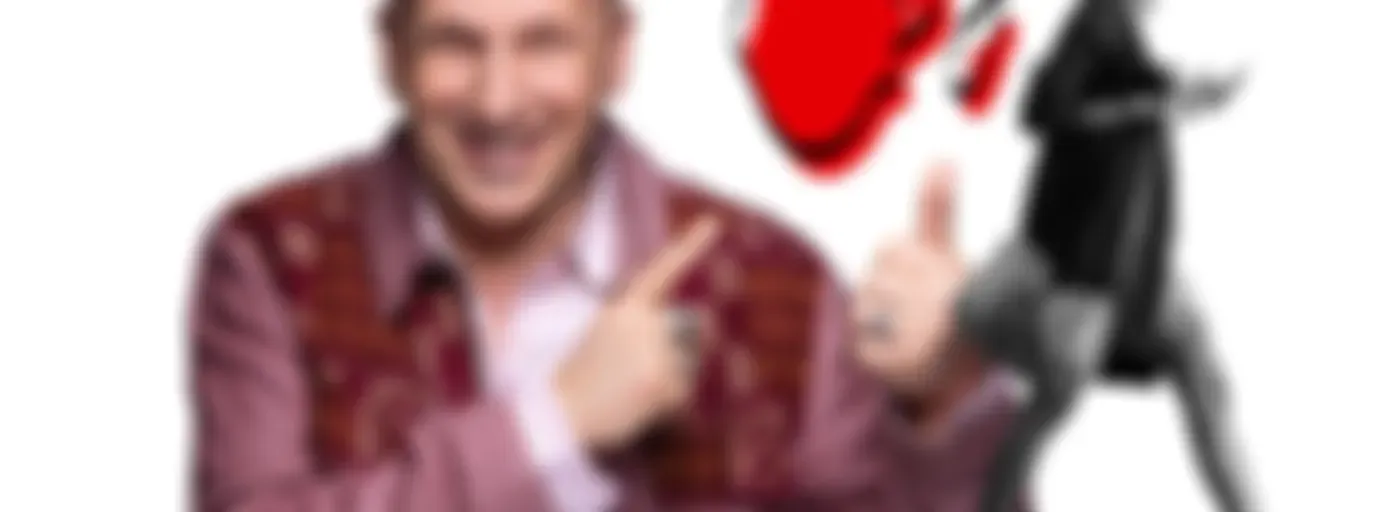

RFI
L'Afrique en marche
L'Afrique positive sur RFI pour découvrir et mettre en valeur des initiatives gagnantes du continent. Une entreprise innovante, une idée qui mérite d'être relayée, un projet auquel nous pouvons donner un coup de pouce... Chaque semaine, nous ferons un focus sur l'Afrique qui marche et qui donne envie d’aller plus loin !
Diffusion : dimanche à 5h47, 7h47 et 12h50 TU.
