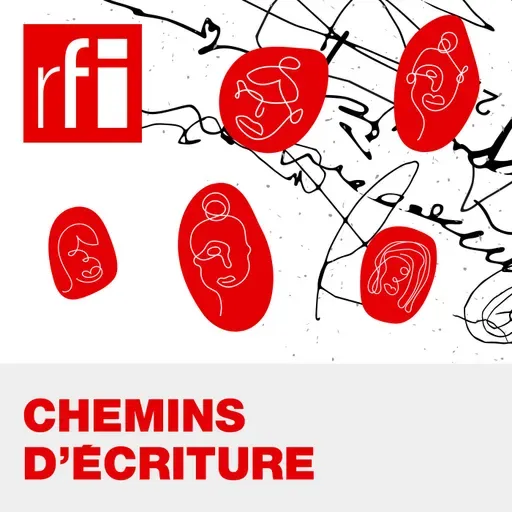
Le romancier franco-togolais Sami Tchak livre avec son nouvel opus Profaner Ananda, paru dans la collection Continents noirs des éditions Gallimard, un récit tendre et fantasmatique de sa complicité littéraire avec l’immense écrivaine d’origine mauricienne, Ananda Devi. Le duo cultive une amitié vieille de vingt ans, nourrie d’échanges, de correspondances et d’interrogations partagées sur la littérature, l’écriture et la vie. Rédigé à quatre mains en collaboration avec la romancière Annie Ferret, ce livre désacralise l’œuvre de Devi pour mieux la célébrer. Entretien avec Sami Tchak.
RFI : Votre nouveau livre s’intitule de manière ingénue « Profaner Ananda », alors qu’en réalité il s’agit ici d’une célébration de la vie et de l’œuvre d’Ananda Devi. Ne craigniez-vous pas qu’on vous reproche de faire de la publicité mensongère ?
Sami Tchak : On nous a déjà fait ce reproche. Voyez-vous, avec ma co-autrice Annie Ferret, nous tenons Ananda Devi pour l’auteure de textes majeurs de notre temps, qui mérite d’être classés dans cette catégorie d’œuvres dont la lecture exige une profanation, qui implique reconnaissance. Pour profaner, il faut d’abord considérer que le temple ou la personne est sacrée. Ananda est humaine, mais le projet de notre livre était d'être à la hauteur de cette puissance littéraire qu’elle a pu atteindre grâce à son travail, son génie, tout en engageant un dialogue sur la nature et la qualité de son œuvre. Ces pages participent à la construction du mythe Ananda car la profanation est vraiment un signe de respect et d’adoration.
Comment est née l’idée de ce projet ?
Ce livre est né d’une proposition que ma co-autrice a reçue de la part d’une revue universitaire américaine pour écrire un texte sur Ananda pour un numéro spécial consacré à cette écrivaine. Moi-même, j’étais alors sur un projet de livre sur Ananda. C'est en lisant le texte d’Annie Ferret que j'ai eu l’idée de fondre nos deux projets. L’ouvrage final a été concrétisé lors d’une résidence d’écriture que nous avons faite ensemble à la Villa Salaambô à Tunis. Cela donne un livre à quatre mains, on pourrait même dire un livre à six mains, en comptant les citations d’Ananda extraites des différents ouvrages de l’auteure. Ces citations sont suffisamment nombreuses pour qu’Ananda fasse, elle aussi, partie de ce livre comme auteure.
Que vos trois noms paraissent ensemble sur la couverture d’un livre n’a rien d’étonnant car vous vous connaissez depuis longtemps. Pourriez-vous parler des circonstances de votre rencontre ?
J’ai rencontré Ananda d’abord par son œuvre. Annie Ferret aussi, d’ailleurs. Un véritable lien d’admiration et de sororité réunit les deux. Quant à moi, je lis Ananda depuis au moins une vingtaine d’années. En 2000, elle publie Moi, l’interdite. Le livre est paru aux éditions Dapper, une maison qui n’existe plus aujourd’hui. À la sortie de ce livre, la revue Africultures a publié un entretien avec l’auteure sous la plume de Boniface Mongo-Mboussa. Je lis l’entretien et j’achète le livre. À partir de ce moment-là, j’ai essayé de lire tout ce que je pouvais trouver sur elle ou par elle, avant que la collection « Continents noirs », qui fête son vingt-cinquième anniversaire cette année, ne devienne l’occasion pour nous de se rencontrer. Nous venions d’entrer dans cette collection à peu près en même temps, elle avec son roman Pagli et moi avec Place des fêtes. Dans les années qui ont suivi, j’ai fini par mieux connaître Ananda. Nous avons établi un échange quasi-quotidien, nous parlions littérature. Nous échangions nos manuscrits pendant la rédaction de nos livres respectifs. Force est de reconnaître que les conseils d’Ananda, qui est une lectrice exigeante, ont fait évoluer mon écriture.
Peut-on parler d’amitié littéraire ?
Disons amitié tout court, qui passe par la littérature, par l’écriture. Parfois je la cherche même dans les interstices de ce qu’elle n’a pas dit. Je suis à la recherche de cette auteure-là à travers son œuvre. Je la lis en la cherchant, je l’imagine même derrière les phrases, au moment où elle les écrit, parce que l’expérience de l’amitié, de la complicité me permet de me faire beaucoup d’images au-delà de ce que le lecteur pourrait percevoir. Je l’imagine donc derrière ses mots, je l’imagine derrière les tournures de phrases, je l’imagine à travers peut-être l’effort qu’elle fait pour que la phrase qu’elle est en train d’écrire soit la plus proche, la plus près possible de ce qu’elle a envie de dire. Je la cherche à travers chaque mot et je la trouve même là où elle ne dit rien...
Votre complicité s’affiche aussi dans vos livres respectifs.
Il y a en effet des clins d’œil, mais aussi des textes plus longs, notamment mon texte intitulé « L’éloge de la sarienne » dans mon livre La couleur de l’écrivain. Ces échanges débouchent aujourd’hui sur Profaner Ananda. Ce livre ne vient pas de nulle part.
Vous êtes un lecteur attentif des romans d’Ananda Devi, mais aussi de sa poésie. Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans son écriture ?
Ananda Devi réussit, que ce soit dans ses poèmes, ses romans ou ses textes personnels, à nous faire sentir l’humanité à travers une expérience bien localisée. Son point de départ, c’est l’Île Maurice, c’est l’Inde, c’est sa famille, mais elle parvient chaque fois, sans doute à cause de son ancrage spirituel, « spirituel » au sens plus large du terme, à nous ancrer dans le monde qu’elle crée, dans l’expérience qu’elle raconte. Elle n’est finalement, comme elle le dit elle-même, qu’une sorte de dépositaire d’une mémoire universelle à partir de son expérience de personne indienne de l’Île Maurice. Son œuvre me frappe par cette capacité qu’elle a à nous englober dans ce que nous avons de plus intime, de plus universel.
Profaner Ananda est aussi un livre sur votre propre parcours d’écrivain, sur la littérature, en particulier sur la littérature africaine dont vous avez été nourri et dont vous pointez les forces et les faiblesses avec beaucoup de lucidité.
Je rends hommage à mes aînés que j’ai beaucoup lus et qui m’ont nourri, mais j’aurais aimé qu’on donne à lire plus tôt dans nos écoles en Afrique les grands auteurs du monde entier. Il me semble que les « classiques africains » qui encombrent les programmes de nos écoles sont insuffisants pour une éducation littéraire. Je suis content pour ma part d’avoir eu l'opportunité de lire autres choses, d’avoir découvert d’autres univers. D’ailleurs, ce n'est pas un auteur africain qui se trouve au sommet de mon panthéon personnel, mais un Russe. Il s’agit de Dostoïevski. Je sais que ce n’est pas très original, mais il se trouve que c’est en lisant les Frères Karamazov, pour ne citer que ce livre-là, que j’ai compris comment fonctionne la littérature. Dostoïevski m’a fait comprendre que l’écrivain n’est pas un moraliste, mais un révélateur d’âme. C’est à la lecture des Frères Karamazov que j’ai compris que le plus grand écrivain est celui qui nous fait toucher les grandeurs et les abîmes du cœur humain. Les personnages les plus sombres dans ses romans sont porteurs de lumières, alors que les personnages les plus évolués sont capables de faire preuve de la barbarie. Dostoïevski m’a appris à me méfier des manichéismes et à considérer l’homme comme un emmêlement de ténèbres et de lumières. Voilà pourquoi je considère l’auteur des Frères Karamazov, de Crime et châtiment comme l’un de mes maîtres à penser et à écrire.
Profaner Ananda, par Sami Tchak et Annie Ferret. Collection « Continents noirs », Gallimard, 123 pages, 18 euros.
