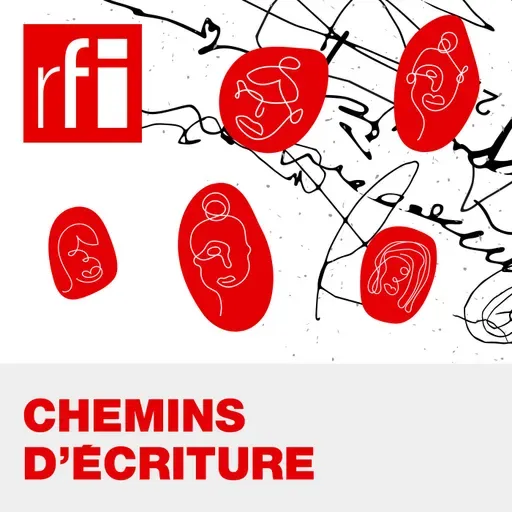
La Réunionnaise Gaëlle Bélem raconte l’inquiétante étrangeté de son île
Chemins d'écriture
Première Réunionnaise à être sélectionnée pour la prestigieuse britannique, le Booker Prize international, pour son premier roman Le monstre est là, derrière la porte, Gaëlle Bélem est une formidable raconteuse d’histoires. On saura le 8 avril, si son roman est retenu dans la shortlist, avant l’annonce du nom du lauréat ou de la lauréate finale en mai. En attendant, l’écrivaine fait paraître son troisième livre, un recueil de nouvelles intitulé Sud sauvage. Dans ce nouvel opus, à travers treize contes campés à mi-chemin entre le fantastique et l’étrange, elle remet en scène une île natale inquiétante, loin de son image paradisiaque d’une terre où la nature est reine. C’est l’envers de la carte postale que propose Gaëlle Bélem dans ses nouvelles. Entretien.
RFI : « Préfère l’impair », disait Verlaine dans son célèbre Art poétique. Vous avez écouté la recommandation du grand poète puisqu’on compte 13 nouvelles dans votre recueil qui sort le 3 avril.
Gaëlle Bélem : Bien entendu, j’ai tenu compte de la recommandation du poète, bien que je ne sois pas superstitieuse. Je suis athée, mais même en étant athée, je sais à quel point ce chiffre treize est important pour ceux qui croient. Ce n’est donc pas accidentel si j’ai choisi d’incorporer treize nouvelles dans ce recueil qui parle justement de croyances, de mystères, et de phénomènes surnaturels.
« Nouvelles horrifiques », avez-vous dit…
Oui, parce que certaines histoires tendent vers l’horrifique, mais le terme fantastique est sans doute beaucoup plus adapté. Ce sont des histoires troublantes, intrigantes, mais elles ne sont pas toutes surnaturelles. Je les ai campées à la frontière du naturel et du surnaturel où on s’arrête et se demande s’il existe réellement des choses que nos yeux ne voient pas. Je ne donne pas mon avis sur le sujet, je me contente de susciter des interrogations, tout en respectant les croyances des lecteurs.
D’où vient votre goût pour le fantastique ?
Ça vient d’Edgard Allan Poe, de Maupassant, de Théophile Gautier et de certain nombre d’autres écrivains du XIXe siècle qui ont, on va dire, « fricoté » avec le fantastique, le surnaturel. J’ai aussi beaucoup lu Lovecraft. L’Appel de Cthulu, L’Abomination de Dunwich… Des livres que j’ai lus dans mon adolescence et qui m’ont profondément marquée. Dans mes nouvelles, je voulais imiter mes modèles et écrire à la manière d’un Maupassant, d’un Poe ou d’un Lovecraft. Je ne sais pas si j’ai vraiment réussi, mais quand j’ai remis le manuscrit à mon éditeur Jean-Noël Schifano, directeur de la collection « Continents noirs » chez Gallimard, il m’a dit que c’était pas mal du tout et qu’il voulait les publier. J’étais contente de cette reconnaissance. J’aime créer des mondes et d’insuffler la vie à des personnages. En écrivant les treize nouvelles de mon recueil, j’ai l’impression d’avoir créé 13 galaxies, treize univers. Écrire me donne un sentiment de puissance créatrice. Je trouve cela enivrant.
Comment ne pas constater que derrière le fantastique, il y a chez vous une volonté de raconter votre Réunion natale !
Je reconnais que dans tous mes écrits, depuis mon premier roman, il y a un souci de peindre la Réunion telle qu’elle est, décrire ses petites gens. Moi-même, je viens d’un milieu populaire, avec des ancêtres qui étaient pour certains des engagés, pour d’autres des esclaves. Je ressuscite le passé de l’île dans mes nouvelles. L’action d’une des nouvelles se déroule dans les ruines d’un château abandonné. Dans une autre nouvelle, je décris des ossements des esclaves échoués sur le rivage. L’objectif est de convoquer à travers la fiction le passé colonial et esclavagiste de l’île. Je raconte aussi la vie contemporaine, à travers des petites gens, perclus de superstitions et d’ennui. Par exemple, dans la nouvelle macabre « Sept têtes », je brosse le portrait d’un homme à l’imagination fertile. Il tombe nez à un nez à un possible meurtrier qui tient entre ses jambes un sac qui sent mauvais et qui contient peut-être des preuves de ses méfaits. La suspicion, le poids de l’histoire, un présent morose, ce sont les composantes du fantastique dans ces pages. En même temps, il y a une appétence chez moi pour le social, pour le populaire, dans toutes leurs extravagances. Mes nouvelles comme mes romans témoignent de cette tendance et ça ne changera pas.
Vous avez appelé votre livre : Sud sauvage. Que vouliez-vous dire par ce qualificatif « sauvage » ?
Native de la Réunion, j’aime à dire que je suis originaire d’une des terres les plus au sud du monde. Menacée par des cyclones et des éruptions volcaniques, cette île est plus proche de l’Antarctique que du béton parisien, plus proche des confins du monde que de son centre. Le « sauvage » dans le titre renvoie aux mystères indomptés, à des créatures qui n’ont pas été apprivoisées par l’homme. Le sud est sauvage car dans nos imaginaires il se situe dans les confins du monde connu : il est opaque à nos logiques cartésiennes. Il y a beaucoup de sarcasme dans ce titre, mais ce n’est pas tout. J’ai nommé mon livre « Sud sauvage » aussi en hommage à l’une des plus belles régions de la Réunion que je connaisse, située quelque part dans le sud-est de l’île et qui porte ce nom évocateur. Composée de plusieurs communes rurales, cette région est l’un de mes lieux préférés de l’île. La région est connue pour ses falaises façonnées par la lave volcanique, contre lesquelles les vagues viennent se fracasser depuis la nuit des temps. Ce paysage, entre mer et terre, dégage une beauté quasi-primitive, originelle, devant laquelle l’homme ne peut que rester pantois d’admiration.
Comment êtes-vous venue à l’écriture, Gaëlle Bélem ?
Voyez-vous, je viens d’un milieu très pauvre où il n’y avait pas d’appétence particulière pour la littérature. J’ai l’habitude de dire que je viens d’une ville où il y a beaucoup de vent. Il s’agit de la ville de Saint-Benoît, une ville située dans l’est de la Réunion. C’est une ville balayée par le vent. Son autre caractéristique : les gens de Saint-Benoît n’ont guère le goût pour la littérature. Les rares livres qu’il y avait chez moi servaient de cale-porte pour empêcher les portes de claquer par temps de grands vents. Cela vous dit à quel point on faisait peu de cas de la littérature chez nous. Mais un jour, j’ai ramassé un des livres qui traînait par terre et j’ai décidé de l’ouvrir et de le lire. Il s’agissait en fait de deux livres. Il y avait Flaubert et il y avait Balzac, Le Père Goriot et Madame Bovary. C’est comme ça que j’ai découvert la littérature, avec ces auteurs du XIXe siècle.
Et aujourd’hui, devenue vous-même auteure de livres, qu’est-ce qu’un livre pour vous, Gaëlle Bélem ?
Un livre, c’est plus qu’une juxtaposition de feuilles griffonnées. Un livre c’est une déclaration d’amour aux lecteurs. Un livre, c’est une mise à nue absolue de l’auteur qui a écrit ce livre et qui s’expose donc à ses lecteurs dans toute sa nudité, c’est-à-dire dans toute sa sincérité, dans toute son authenticité, dans toute sa fragilité, à ses lecteurs. Un livre, c’est un pont, une invitation au voyage dans un monde idéal, parfois…
Sud sauvage, par Gaëlle Bélem. Collection « Continents noirs », éditions Gallimard, 163 pages, 19 euros.
