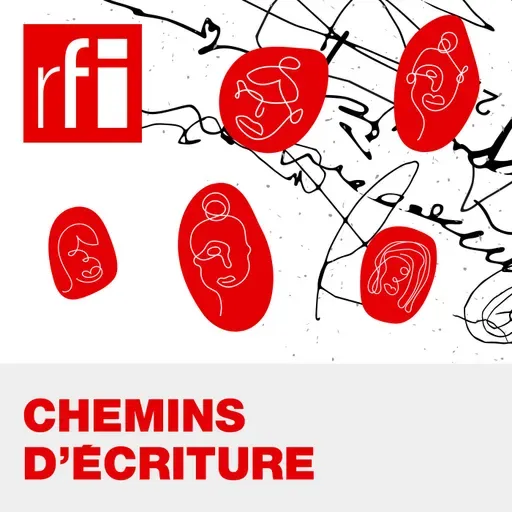
Khalid Zekri: «Le passé simple de Driss Chraïbi fut un tournant dans la littérature marocaine»
Chemins d'écriture
Ce weekend, Chemins d’écriture est à l’heure marocaine, avec Driss Chraïbi et Khalid Zekri. Le professeur Zekri enseigne la littérature à l’université Moulay Ismaïl de Meknès. Il répond aux questions de RFI sur Driss Chraïbi, le romancier emblématique du royaume chérifien, et sur son roman incandescent Le Passé simple, paru en 1954, qui fit décoller la fiction marocaine moderne.
RFI : Lors de sa parution en 1954, La passé simple (Denoël) scandalisa ses lecteurs à cause de sa satire féroce de la société marocaine et de sa soumission à l’ordre patriarcal et colonial, avant d’être réhabilité après l’indépendance du Maroc. Quel souvenir gardez-vous de votre première lecture de ce roman devenu aujourd’hui un classique ?
Khalid Zekri : J’ai découvert Le Passé simple à la fin du collège, mais je l’ai lu réellement au lycée, en même temps que je lisais les classiques français inscrits au programme des études littéraires. L’écriture de Driss Chraïbi m’avait frappé à cause de sa rupture avec les conventions littéraires auxquelles j’étais habitué en tant que lycéen nourri des classiques. Mais, je me rappelle bien, ce texte m’avait ébloui parce qu’il parlait des choses que je vivais, que des gens de ma génération vivaient – à quelques nuances près – par exemple, cette révolte contre l’ordre établi, contre la société patriarcale, contre la pression de la tradition. Nous sentions qu’il y avait une pesanteur sociale qui était décrite sur le plan familial par Driss Chraïbi à travers son personnage Driss Ferdi et son rapport au père, à son père surtout. Il faut bien dire que je ne m’identifiais pas au personnage parce que mon rapport au père était plutôt apaisé, avec bien sûr le souci de me démarquer comme tout adolescent par rapport à la figure paternelle. Ce que Driss Ferdi vivait avec son père Hajji Fatmi Fedi, c’était très représentatif de la pression qu’exerce la tradition, notamment religieuse, sur un jeune adolescent qui était formé dans l’école française, mais qui vivait en même temps dans un bain culturel traditionnel marocain. C’était le cas de Driss Ferdi et de Driss Chraïbi par ricochet.
On a parlé de récit autobiographique, sans doute à cause de l’identité des prénoms entre l’auteur et son protagoniste. Ils se prénomment Driss tous les deux. Mais ce n’est peut-être pas la seule raison.
L’identité des prénoms n’est certes pas accidentelle, mais pour autant il ne s’agit pas ici d’autofiction. Il y a des bribes autobiographiques bien sûr, mais ce n’est pas vraiment une autobiographie. On peut à la limite qualifier l’ouvrage de roman autobiographique. Ce roman comporte des éléments de la biographie de l’auteur qui a été l’élève de l’école française comme son protagoniste et a dû faire face aussi parallèlement à toute cette pression que les jeunes de la génération de Chraïbi vivaient dans l’école coranique. À cela s’ajoute la difficulté de l’émergence de l’individu dans une société où il y a une surdétermination de la tradition telle qu’elle est décrite dans Le passé simple par Driss Chraïbi. Son texte critique également la culture française. Certes, cette critique ne va pas très loin dans ce premier livre. En revanche, c’est dans les romans ultérieurs de Chraïbi que cette critique se fait plus insistante, voire acerbe, et laisse entendre une véritable désillusion par rapport à la tradition occidentale.
Dans quelles circonstances, Driss Chraibi, écrit-il ce premier roman ?
Il l’a écrit alors qu’il faisait ses études en France. Il était parti du Maroc après l’obtention de son baccalauréat. Il faisait des études de chimie pour répondre aux attentes de son père qui voulait voir son fils réussir. Mais comme les études scientifiques ne répondaient pas à sa quête personnelle, le jeune Chraïbi va arrêter ses études en 1952 et se lancer dans l’écriture de son roman qui sera publié en 1954. L’auteur n’a alors que 28 ans. Cela dit, ses études de chimie n’ont pas été une perte de temps, puisqu’il va s’en inspirer pour les sous-titres de son roman, inspirés des étapes de la réaction chimique.
Que raconte Le Passé simple ?
Les premiers romans marocains francophones du patriarcatdatent des années 1930-40. C’était souvent des récits ethnographiques, des témoignages sociologiques. Le Passé simple, c’est un tournant par la thématique même qui est très osée. C’est un jeune Marocain qui va s’insurger contre la pesanteur de la tradition et du patriarcat. Il s’affronte à son père qu’il appelle « le Seigneur », qui est une qualification féodale oppressive. Sa mère est écrasée par ce père tout-puissant. D’ailleurs, elle finira par se suicider dans le roman. Son frère meurt, frappé par le père. Le héros du roman, Driss Ferdi, va entrer alors dans un conflit ouvert avec son père, qui concentre en lui toute la symbolique du père, toute la symbolique du père porteur de tradition, porteur de filiation avec le passé, etc. Ce père est aussi une figure d’oppression parce qu’il est perçu comme un obstacle à l’épanouissement de la subjectivité en tant qu’individu, que cherche justement le jeune Driss Ferdi.
Comment faut-il entendre le titre du roman ? Le passé simple n’est pas simplement un jeu de mots.
C’est surtout un titre polysémique, fondé sur l’ambiguïté de sens. Au sens littéral du terme, il renvoie à la modalité verbale du temps au passé dans la grammaire française. C’est un temps de conjugaison. C’est le temps du récit. Le jeu de mots sous-jacent dans le titre questionne le passé « simple » par opposition à la modernité complexe. C’est un titre programmatique, qui est annonciateur du cœur du récit, où la tradition, synonyme du passé, s’oppose au monde qui se prépare, nécessairement plus ouvert, plus dynamique, moins figé. Pour autant, l’œuvre de Driss Chraïbi est loin d’être une célébration de la modernité, car elle n’hésite pas à critiquer les aspects négatifs de la modernité.
A part le meurtre symbolique du père, quels sont les autres thèmes et motifs abordés dans ce roman ?
Les thèmes abordés dans ce texte vont de la remise en question de l’immobilisme politique, sociale et morale de la bourgeoisie marocaine à la nécessaire critique de la religion qui enferme la population dans une série de règles sans nécessairement proposer les clés d’une véritable émancipation spirituelle. Le narrateur pourfend cette société traditionnelle qui ne permet pas à ses hommes et femmes de s’affirmer en tant qu’individu. Pour le protagoniste, l’école française sera un temps son refuge, mais très vite, il se retrouve prisonnier des contradictions existentielles entre le milieu traditionnel dont il est issu et l’idéal occidental auquel il aspire.
Ce roman frappe aussi par son inventivité linguistique et formelle, à mille lieux des classiques de la littérature française que lisaient les petits Marocains dans les années 1950, sous le protectorat.
Le Passé simple est un tournant, aussi bien au niveau du thème abordé qu’au niveau de la forme puisque c’est une écriture qui n’est pas linéaire, qui n’est pas, disons, docile par rapport à la langue française au niveau du style. Il y a une volonté de déconstruire certaines structures syntaxiques, il y a également l’usage d’un vocabulaire d’une très grande violence. C’est un tournant dans la littérature. D’ailleurs, un journaliste à l’époque a dit qu’on entre dans ce roman comme dans les maisons de la vieille médina, on s’y cogne la tête à chaque coin. En fait, on y entre difficilement. Ca veut dire que la langue dans laquelle est écrit le texte produit un effet d’étrangeté chez le lecteur.
Cet effet d’étrangeté explique-t-il la polémique qu’a suscitée ce roman lors de sa parution en 1954 ?
Il est vrai que dans un premier temps, le lectorat ne s’est pas reconnu dans le portrait que ce roman brosse de la société marocaine et de son élite au sortir de la colonisation. Comme Chraïbi dénonce aussi bien la tradition que le protectorat, il était critiqué à la fois par la droite coloniale et les nationalistes marocains. Une critique du livre qualifie l’auteur d’« assassin de l’espérance ». Ces critiques sont tellement virulentes qu’elles vont pousser Drisse Chraïbi à renier son texte. Mais il sera réhabilité dans les années 1960 par les intellectuels proches de la revue avant-gardiste Souffles, qui ont fait la leur la lutte de l’auteur du Passé simple contre la société sclérosée, contre l’immobilisme social et culturel, et la renaissance de la pensée marocaine. Souffles qui comptait dans son ours outre le fondateur Abdellatif Laâbi, d’autres romanciers et poètes de haute volée tels que Mohammed Khaïr-Eddine, Tahar Ben Jelloun, Mostefa Nissaboury, prirent la défence du romancier et écrivait dès son cinquième numéro en rappelant que Chraïbi était « le seul écrivain maghrébin et arabe qui ait eu le courage de mettre tout un peuple devant ses lâchetés ».
►Khalid Zekri est professeur et directeur du Laboratoire de Recherche sur la Culture, le Genre et la Littérature (LaRCGL), à Université Moulay Ismail de Meknès, Faculté des Lettres et des Sciences Humaies. Il est également critique littéraire. Il est l'auteur de notamment Fictions du réel. Modernité romanesque et écriture du réel au Maroc, 1990-2006 (L'Harmattan, 2006) et de nombreux articles sur les littératures du Maghreb. Il a participé récemment à l'ouvrage La Migration des Français au Maroc (La Croisée des Chemins, Casablanca, 2016), coordonné par Catherine Therrien.
