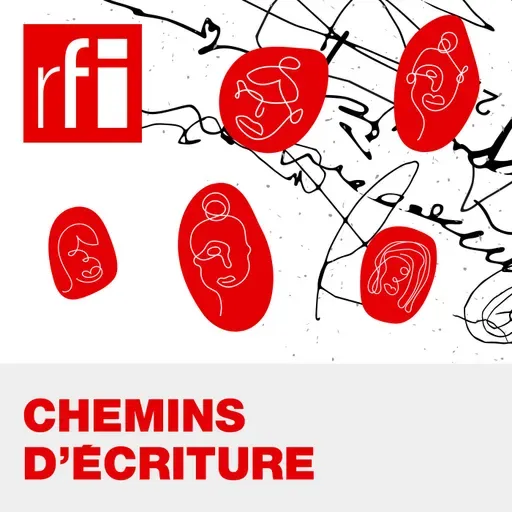
Décédé il y a trente ans, au cours de l’été 1995, le Congolais Sony Labou Tansi a été l’un des écrivains les plus novateurs de la littérature africaine contemporaine. Révélé dans les années 1970, grâce à un concours de théâtre organisé par RFI, le Congolais a été un auteur protéiforme, excellant aussi bien dans le théâtre, la poésie que dans le roman. Avec six romans à son actif dont l’inventivité verbale commence dès le titre, La Vie et demie, L’État honteux ou encore Les sept solitudes de Lorsa Lopez, l’écrivain a révolutionné l’écriture romanesque en rompant définitivement avec le social-réalisme qui a longtemps dominé la fiction africaine. La Vie et demie, son premier roman devenu un classique francophone, puise son inspiration dans le « réalisme merveilleux » latino-américain.
« C’était l’année où Chaïdana avait eu quinze ans. Mais le temps. Le temps est par terre. Le ciel, la terre, les choses, tout. Complètement par terre. C’était au temps où la terre était encore ronde, où la mer était la mer – où la forêt… Non ! la forêt ne compte pas, maintenant que le ciment armé habite les cervelles ».
Nous sommes ici au cœur des ténèbres, dès les premières pages. C’est la fin du monde, du monde connu. Les continents sont entrés en collision. L’apocalypse now, hier, demain. … Ainsi commence La vie et demie de Sony Labou Tansi, l’un des romans-phares de la littérature africaine moderne. Paru en 1979, le volume annonce l’entrée en scène d’une nouvelle génération d’écrivains africains, qui quittent les bords de la Seine et de la Loire pour aller puiser leur inspiration dans la littérature mondiale, notamment dans la littérature latino-américaine.
Cruel et drolatiqueÀ la fois cruel et drolatique, ce premier roman sous la plume d’un Congolais peu connu à l’époque se veut une satire féroce de l’Afrique des régimes dictatoriaux. Le contexte politique congolais dont s’inspire Sony Labou Tansi, se caractérise par la logorrhée verbale marxisante de son élite, appelant à la révolution, afin de mieux piller les richesses du pays. Pour raconter ces hypocrisies, l’auteur congolais privilégie le ludique, le parodique et le baroque, arrachant la fiction africaine à son ancrage sociale et auto-célébrationnel, pour l’inscrire fermement dans le réalisme critique. La Vie et demie, dépouillée de toute intention didactique s’inscrit dans cette mouvance.
Toute l’œuvre de Sony Labou Tansi se caractérise par une tension constante entre révolte et quête, entre une pluralité d’imaginaires, entre langues, notamment le lingala qui est la langue maternelle de l’auteur et le français qu’il apprend à l’adolescence, comme le raconte l’universitaire et la réalisatrice d’un film sur l’écrivain, Julie Peghini.
« Sony Labou Tansi est né en 1947 dans l’ex-Congo belge. Il était scolarisé en langues, en kikongo et en lingala. Et puis très rapidement, on lui a fait passer le fleuve et il aimait dire qu’il avait un fleuve entre les jambes, il n’y avait pas de frontière pour lui et il est parti de l’autre côté du fleuve. Donc au Congo-Brazzaville où il est parti pour être scolarisé en français. Il a écrit très tôt dès les années de collège. D’abord de la poésie, puis il s’est mis à écrire des romans. Il a aussi créé en même temps sa troupe de théâtre, le Rocado Zulu Théâtre, avec laquelle il est parti beaucoup aux Francophonies de Limoges, mais aussi dans beaucoup d’autres pays d’Europe ».
C’est la publication en 1979 de La vie et demie qui a lancé la carrière de Sony Labou Tansi. Difficile de résumer ce roman, car sa narration sophistiquée et complexe procède par successions d’images caricaturales et insoutenables, privilégiant le visuel et l’esthétique, aux dépens du narratif. Orgies sexuelles, exécutions sommaires, supplices, banquets carnavalesques se suivent et se ressemblent dans ces pages qui n’hésitent pas à convoquer les morts qui viennent donner un coup de main aux vivants.
Bienvenue à KatalamanasieLe roman s’ouvre sur une scène de banquet organisé par le chef de l’État pour fêter sa victoire sur Martial, le chef de l’opposition. La mise à mort barbare de l'opposant se déroule sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Ces derniers se retrouvent ensuite au banquet anthropophagique où on les oblige à manger le corps de leur parent, réduit littéralement en chair à pâté et en daube. Nous sommes en Katamalanasie, pays imaginaire d’Afrique, sur lequel règnent des générations de « guides providentiels » dont les méfaits se reproduisent à l’identique en une sorte de cercle vicieux, infernal et répétitif. Victime principale de la terreur que fait régner cette dynastie des dictateurs sanguinaires à la tête de leur pays, la population s’épuise et désespère.
L’espoir va renaître, avec le retour du spectre du défunt Martial revenu hanter les « guides providentiels ». Dans les œuvres de Sony Labou Tansi où le réel côtoie le fantastique, les morts n’y meurent jamais tout à fait. Ainsi dans le fantôme de l’opposant assassiné imprime sur le visage des tyrans une marque noire, les condamnant à l’impuissance et à la folie. Parallèlement, la fille de Martial, l’unique rescapée de la famille du traître, prend la tête de la rébellion contre la dictature. Habitée par l’esprit de son père, la belle Chaïdana se vengera des méfaits du régime, éliminant au cours des ébats amoureux les membres les plus influents de la dictature katamalanasienne. Devenue une véritable machine à tuer, elle entraîne le lecteur dans un labyrinthe d’intrigues, conduisant son peuple à travers sa lointaine descendance vers la victoire finale.
« Sony Labou Tansi a lutté contre la mort de la vie, explique Julie Peghini. C’est pour ça qu’il écrivait. C’est un écrivain universel qui a été malencontreusement, je crois, dans tous les malentendus postcoloniaux, qualifié d’écrivain des dictatures, mais c’étaient pas les dictatures qu’il nommait seulement. Ce n’étaient pas les dictatures qu’il nommait seulement. Loin de là. C’était vraiment la honte d’être humain, il parlait de l’état honteux. En ce sens-là, nommer la honte, c’est une fonction universelle de l’écrivain ».
Résonances shakespeariennesLa Vie et demie raconte « les névroses d’une société bloquée », rappelle le critique auteur Boniface Mongo-Mboussa. Les modèles de Sony Labou Tansi ne sont ni Balzac ni Zola, mais plutôt la fantaisie débridée et loufoque à la Gabriel Garcia Marquez, ce qui est sans doute plus adaptée pour dire les dysfonctionnements de l’Afrique des dictatures et des guerres civiles qu’incarne la république imaginaire de Katalamanasie.
C’est aussi un livre très littéraire, riche en résonances shakespeariennes – pensez à Macbeth assailli par les fantômes sanglants de ses victimes. L’héroïne du roman, Chaïdana, partageant la couche du Guide providentiel dont dépend sa vie, n’est pas sans rappeler le destin de Schéhérazade dans Mille et une nuits. Bref, malgré les ténèbres qui encombrent ses pages. Longtemps après avoir refermé le volume, le lecteur ne garde en tête que l’inventivité jouissive de son auteur qui prophétisait qu’« un jour, la terre et le ciel se recoudront ».
La Vie et demie, par Sony Labou Tansi. Éditions du Seuil, 1979 (disponible en édition poche)